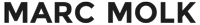Jean-Yves Jouannais
« Tout se mélange dans mon esprit », mars 2011
Jean-Yves Jouannais : Je suis très intrigué par l’insistance avec laquelle tu désignes nombre de tes toiles par un titre exotérique, destiné à un large public, et par un intitulé ésotérique, confidentiel. Même si tu sembles le faire sur un ton badin, je voulais savoir si tes images se donnent à décrypter suivant cette double logique. Pour reprendre une image classique de l’ésotérisme, existe-t-il dans tes images, à la fois une écorce et un noyau, un corps et une moelle ?
D’avoir pu lire ton livre Pertes humaines, qui est en partie autofictionnel, m’invite à évoquer une hypothèse. C’est comme si le noyau ou la moelle de tes tableaux était essentiellement constitué d’une matière enracinée dans les émois de l’enfance et de l’adolescence, tandis que l’écorce ou le corps consistait en leur manifestation adulte, mature, politique. Je pense en particulier aux Noces Vermeilles alias « La Vie de ma soeur » ou bien encore à La Troisième République alias « La Mort de Daniel ».
Marc Molk : C’est vrai. C’est un petit secret en fait. Tu l’éventes et tu m’en débarrasses. Cela me plaît… cela m’embarrasse aussi. Je ne voudrais pas passer pour quelqu’un de trop sophistiqué, ce que je suis peut-être malheureusement. Chacun de mes tableaux a un titre « officiel » et un titre « privé ». Savoir si ce sens caché doit être recherché, deviné par les autres, je ne crois pas. Ce n’est pas intéressant, cela a toujours trait à ma vie privée. Cela enfermerait chaque toile dans une anecdote biographique au lieu de la laisser vivre sa vie d’objet herméneutique flottant.
Mes émois sont déclenchés par la vie de ceux que j’aime. Que ces émois, cette matière affective, cette « moelle » dont tu parles (qui ne vient pas seulement de l’enfance ou de l’adolescence, mais d’une tristesse de caractère, au fond) soit présente, indispensable, c’est indéniable. Elle motive la réalisation du tableau, elle participe aux choix des éléments qui le constituent et, surtout, elle détermine qui en sera le spectateur idéal, le destinataire, « qui » est en quelque sorte « la raison du tableau ». Roland Barthes écrit dans Fragments d’un discours amoureux que lorsque l’on tient un discours sur l’Amour, même le plus théorique, on s’adresse toujours à quelqu’un en secret. Un propos sur l’amour est toujours, quoi qu’on en dise, « allocutoire ». Eh bien je crois que j’ai besoin de ce dispositif aussi pour peindre (pour écrire également d’ailleurs).
J’essaie ensuite de dégager un maximum d’équivocité de cette gadoue affective primordiale. Pour ce faire, le genre de l’allégorie (si décrié, ringardisé, réputé lourdaud) que je pratique, est parfait. Il permet de faire mine de figer le sens d’un tableau en suggérant qu’il en existe plusieurs autres. En fait, pour peu que l’on n’y aille pas à fond, façon souk, sur l’attirail des signes, c’est un genre très subtil. Ce qu’il s’agit de doser, c’est l’emploi et la visibilité des symboles, qui ne sont pas indispensables à une allégorie et sont de simples accessoires, à disposition, plus ou moins clinquants. J’essaie autant que possible de pratiquer une symbolique enfouie. Lorsque j’introduis la couronne du Christ dans un tableau, ça tape fort, à un endroit répertorié. Avec une boule disco, c’est déjà plus flou : la Terre ? Le Soleil ? La Nuit ? La Fête ? La Perdition ? Avec une hyène qui bâille dans un coin, on est vraiment loin, je crois, du compas et de l’équerre. Idéalement, j’aimerais transformer des gestes, des postures en symboles (cf. Georges de La Tour, ou Caravage bien sûr), alors je m’intéresse beaucoup à la danse dans cette perspective, mais pour l’instant je ne m’y suis risqué que très timidement. Cet enfouissement des symboles produit des allégories plutôt réalistes, dont le sens n’est pas cadenassé.
Je parle à propos de mes toiles « d’objets herméneutiques flottants » parce que je ne poursuis pas une cohérence fermée, préméditée. J’insère dans mes tableaux des éléments pertinents pour moi, confidentiels, des symboles recevables sur un plan allégorique mais aussi des éléments qui n’ont pas l’air de symboles, qui n’en sont pas à proprement parler, qui ne concernent ni le versant intime ni le versant public du tableau, et qui fonctionnent tout de même comme des indices de sens. Seulement ce sont des indices qui ne pointent rien, en vérité. Ma phrase va être cuistrissime mais je joue, de temps en temps, avec l’esthétique de la dénotation de sens, sans qu’aucun sens réellement constitué ne soit visé. C’est du bluff, je fais mon miel de l’« allure » évocatrice de tel détail, qui ne recouvre rien. Mes tableaux sont bien en partie secrets, mais pas comme on pourrait le croire, pas comme ils se donnent à deviner. Il y a un pourcentage d’hermétisme fantaisie, de signifiants creux sur la toile, de simples éléments d’ambiance. Ils « ouvrent » le tableau, ils l’oxygènent. C’est un peu comme dans une certaine poésie où il faut se débarrasser du référent (on n’y parvient jamais tout à fait) pour que les mots fleurissent. À d’autres moments, souvent, je veux signifier quelque chose de précis et je vois bien que personne ne comprendra ce que j’ai voulu dire. Pourtant, je le peins quand même, consciencieusement, et je fais remarquer plus tard au destinataire original du tableau (qui n’a rien demandé et n’en est presque jamais le propriétaire in fine) la présence de mon intention à cet endroit.
Enfin, le titre est essentiel, qui peut transformer une scène somme toute très réaliste en pure représentation, par la magie de la désignation, et tous les détails du tableau en symboles potentiels, comme lorsque l’on verse du champagne en cascade sur le sommet d’une pyramide de coupes et que les dernières, à la base, finissent elles aussi, un peu incroyablement, par se remplir. Le titre, en outre, aplanit tout, lisse l’ensemble, lui donne « les atours » de l’unité, d’une logique implacable. Et cela suffit souvent. C’est presque trop facile.
Dans cette jungle, chaque toile a ensuite un destin, auquel je reste attentif et qui pèse sur son sens. Chaque toile a une histoire, à son échelle. Il y a des tableaux que je cache, dont certaines personnes ne doivent pas connaître l’existence, car en découleraient pour moi des ennuis familiaux, ou encore des toiles qui ont donné lieu à des interprétations erronées d’amis proches, mais des interprétations tellement belles que je serais bien incapable d’y apporter un démenti, et que je finis par reprendre à mon compte.
Maintenant, pour te répondre de front : oui, il y a une moelle et une écorce, mais j’espère, je veux croire que j’ai fait en sorte qu’il y ait mille moelles et mille écorces. Évidemment. On veut toujours tout. Durant la révolution, ajouter des couplets à « La Marseillaise » était chose courante et admise, évidente. Tout le monde en rajoutait. Puis cette tradition s’est perdue, des couplets « officiels » ont été choisis, et c’est devenu « LA Marseillaise ». « La Marseillaise » devrait toujours être en train de s’écrire, à chaque élection, à chaque événement politique significatif… alors si j’en avais la possibilité, si c’était praticable, je laisserais chaque spectateur de mes tableaux leur trouver un nouveau titre, un titre supplémentaire, un titre qui lui parlerait à elle ou à lui, qu’il écrirait à la suite des autres sur un cartel interminable. Ce serait une bonne chose, que mes tableaux deviennent chacun le « prétexte » d’une oeuvre littéraire collective et infinie. Parce qu’au final, le sens véritable d’une toile n’est pas si important. Ce qui compte, c’est l’intuition d’un sens qu’elle nous procure.
J-YJ : À la fin de sa vie, Michel Foucault a tenté de radicaliser son intuition quant à une pratique du « dire vrai ». Je crois qu’il n’a rien écrit là-dessus mais que c’était le sujet de ses dernières leçons au Collège de France. Il aboutit à une description de trois figures types : le militant révolutionnaire, le héros philosophique et l’artiste maudit, qui étaient à ses yeux trois figures passionnées par la vérité et jamais embarrassées par le souci de la démagogie. Et selon lui ces trois figures étaient issues d’une lignée improbable qui commençait avec les cyniques grecs, et qui passait bizarrement par l’ascétisme chrétien du moyen-âge. C’est vrai que c’est une drôle de généalogie : il est difficile de faire le lien entre Diogène et les Dominicains (les ordres mendiants du XIIIe siècle). Or ce que Foucault explique, c’est qu’on trouve dans cet ascétisme motivé par la foi un certain nombre de postures ou de comportements qui sont proprement cyniques — le parti pris de dénuement, de pauvreté, du rejet des principes d’apparence… Saint Augustin lui-même, dans La Cité de Dieu, reconnaît cette parenté entre la philosophie cynique et le christianisme tel qu’il le défend. Il y a également quelque chose de cet ordre chez Saint Jérôme quand il invite les Chrétiens à ne pas se montrer inférieurs à un philosophe tel que Diogène.
Tout cela pour en arriver au fait que j’ai l’impression qu’il existe au seuil de ta pratique une velléité extrêmement puissante de dire le vrai mais que l’ensemble des techniques, des outils, de la grammaire et de l’esprit que tu convoques pour le faire tendent à masquer, à voiler, à travestir ce « dire vrai ». Tu insistes beaucoup sur l’usage que tu fais de l’allégorie. J.L. Borges écrivait, quant à lui, que l’allégorie manifestait ouvertement la propension de tout art à produire du faux, du mensonge, et à faire de tout artiste un Gongora en puissance. Il existe là une très forte tension au travail, non pas au coeur, mais vraiment au seuil de ton oeuvre, et qui la rend passionnante. C’est comme si cette taxinomie bizarre à quoi tu te livres, faisant visiter tes toiles comme autant de petites boutiques d’emblèmes, de motifs décoratifs, d’allégories, mais encore « de signifiants creux sur la toile », ou « de simples éléments d’ambiance », avait pour mission d’opacifier un lieu, un site où tout était en place et où tout était d’accord pour que du vrai se dise. Ce site psychique, tu le désignes dès le début, est l’endroit où se forme une crainte : « Savoir si ce sens caché doit être recherché, deviné par les autres, je ne crois pas. Ce n’est pas intéressant, cela a trait toujours à ma vie privée. Cela enfermerait chaque toile dans une anecdote biographique au lieu de la laisser vivre sa vie d’objet herméneutique flottant ».
D’où vient cette sensation d’enfermer, de restreindre la portée d’une oeuvre en la liant trop explicitement à une donnée biographique ? Désolé de te ramener là où tu ne désires pas aller.
MM : Que peut bien valoir ma vie ? Je ne suis pas Napoléon, il n’y aura jamais de couronnement à peindre si je creuse dans cette seule direction… Ce sera terne.
En ce qui concerne la vérité, j’avoue que c’est une notion mineure pour moi. Pour te donner un exemple intime, sur son lit de mort à Marseille, ma grand-mère, qui a joué toute sa vie au Loto, s’inquiétait de savoir sa fille à l’abri du besoin alors que mes parents étaient en train de divorcer. Elle s’en inquiétait tellement que cela confinait au délire, et elle questionnait dans ses râles tous les jours ma mère à ce propos, qui était dans un grand état de détresse, d’impuissance à la rassurer autant qu’à la sauver. Finalement sa fille lui a chuchoté à l’oreille : « Ne t’inquiète pas Maman, ne le répète pas mais, il y a un mois, j’ai gagné le Super Loto ! ». Ma grand-mère ahurie n’a trouvé à lui répondre en s’enfonçant dans son oreiller que : « Ah ! Tu vois bien que ça a été utile que je joue pendant toutes ces années ! ». Immédiatement, elle a semblé immensément soulagée, et elle souriait, en regardant le vide. Le soir même, nous devions repartir avec le ferry en Corse, où nous habitions. C’est le capitaine qui a prévenu ma mère en pleine nuit de la mort de ma grand-mère, car nous avions laissé le numéro de la SNCM à l’hôpital. Elle pleurait dans l’obscurité de la cabine où ma soeur et moi, silencieux, l’écoutions. Peu de temps après, ma mère, qui avait toujours considéré que le Loto était un jeu débile destiné à faire payer aux pauvres le droit de rêver, s’est mise à y jouer tous les jours. Depuis plus de vingt ans, elle joue au Loto. Si elle gagnait, elle pourrait se dire qu’elle n’a pas tout à fait menti, qu’elle s’est juste un peu emmêlée dans les dates. Elle ne s’arrêtera pas… Passons, ce n’est pas la question. Est-ce que ma grand-mère avait besoin de la vérité ? Sûrement pas. J’avais environ seize ans et j’étais dans la chambre à ce moment-là, à ce moment d’invention. Je n’ai rien dit, j’étais sidéré. J’ai trouvé ce geste, ce mensonge de ma mère, esthétiquement parfait. Ma grand-mère était condamnée, cancer métastasé du foie, elle était toute jaune, dans la masse, et souffrait comme on ne peut pas l’imaginer. Nous pensions que son calvaire allait encore durer quelques semaines, mais non. Il a cessé ce soir-là. Ce que je veux te dire, c’est que toute la vérité d’un amour peut être contenue dans un mensonge, et qu’il peut être une délivrance. Était-ce crédible cette histoire de Super Loto ? Non, pas plus qu’un poème de Gongora n’est sobre. Pourtant, cela a fonctionné. Il y a des situations où le régime de la vérité échappe au réel, au conventionnel, où l’essentiel se passe à un autre niveau. La véridiction peut être paradoxale. J’entends souvent les gens dire : « Après la mort il n’y a rien ». Ces mêmes personnes peuvent t’avouer ensuite un chagrin et, pour eux, c’est un fait, un obstacle, invisible mais concret. Si tu leur dis quelque chose du style : « Allons ! Secoue-toi un peu », ils s’énervent très fort ! Pourtant quelle preuve peuvent-ils apporter de l’existence de leur chagrin sinon l’affirmation : « Je suis chagrin ». Techniquement, en eux, « il n’y a rien », et l’on serait bien en peine de trouver quelque chose que l’on appellerait « chagrin » sous leurs ongles ou derrière leurs oreilles. Pourtant il existe ce chagrin. Alors, je t’en fiche mon billet : il suffit de dire « Le paradis existe » pour qu’il existe, véritablement. On vient de le créer. C’est aussi cela la vérité. Je ne parle pas seulement d’une sorte de performativité subjective du langage, mais d’une performativité effective du langage, d’une performativité « pour de vrai », bien qu’intangible, invérifiable. Tout est vrai, absolument : une chose et son contraire, le mouillé et le sec, le dur et le fragile, etc. Alors, Le Courage de la vérité, c’est le courage de vivre tout court.
Je ne sais pas si c’est une réponse à ta question, je ne crois pas, il s’agit sans doute davantage d’une réaction. Je ne sais pas si tu n’as pas raison de m’interroger sur une sorte de sincérité biographique radicale qu’appellerait – et dont se détournerait à la fois – ma peinture. Tu as raison. Je ne suis sans doute pas assez serein encore pour me consacrer au seul recueillement de la vie comme elle vient. Peut-être ma pratique de la peinture est-elle impure. Je me sens pris en tenaille entre la pulsion biographique, pas au nom de la vérité mais en tant qu’historien de mes proches, et une pulsion que je qualifierais de « platonicienne », qui me pousse à peindre des Idées, des abstractions, pour les autres : « La libération sexuelle » ou « La promesse du bonheur » pour donner des exemples. La seule technique que j’ai trouvée me permettant ce grand écart dans le même tableau, c’est l’allégorie. J.L. Borges est bien gentil… mais va-t-on jeter les allégories de Goya sur les diktats de Borges ? Non. L’allégorie est un genre factice, soit, mais j’ai répondu à cette contradiction, à la question du vrai et du faux. Je crois que, plus profondément, ce que l’on reproche à l’allégorie, c’est une naïveté à laquelle on se refuse à croire. Cette naïveté nous semble factice, parce que nous sommes cyniques, parfaitement (tu as parlé de cynisme noble, j’en dénonce ici l’aporie). La peinture du Grand Siècle plaçait l’allégorie au sommet de la hiérarchie des genres, elle dégageait chez ses spectateurs un sentiment de majesté, celui d’une grandiosité du sens. Seulement qui de nos jours pense encore à « l’humiliation de l’innocent châtié », ou à la beauté de la notion de « circonstance atténuante », dans l’absolu, devant une allégorie de la Justice ? Évidemment que ce type d’images sonne faux, c’est nous qui sommes vides, c’est nous qui sonnons creux !
Je suis bien courageux de peindre des allégories, tandis qu’en face de moi les moqueries du matérialisme triomphant (qui réclame du réalisme hardcore, comme si sa soif de concret et d’absence de toute contrainte symbolique, de tout référent extérieur, n’était pas encore complètement satisfaite), tandis que les moqueries d’une barbarie moderne (qui nous laisse tous abandonnés le cul par terre au milieu des choses, avec pour seul luxe de pouvoir les acheter ou les vendre), tandis que toutes ces moqueries discréditent d’emblée, a priori, ma peinture. Il faut du courage pour rester là à braver le narquois (le narquois est un cynique qui jubile. Ma peinture introduit déjà en lui, en douce, un frisson). Je suis courageux.
Je ne pense pas, par ailleurs, être dans l’exagération, m’abandonner à la pente des allégories embouteillées de symboles ou à celle des allégories cuculs, façon Bouguereau. Moi aussi, j’ai du mal avec les falbalas, les outrances ou les affectations chichiteuses. J’ai mon côté Quevedo. J’ai évoqué l’enfouissement des symboles dans mes tableaux, et tu remarqueras aussi qu’ils ne « regorgent » pas d’éléments, que je ne suis pas dans l’accumulation baroque. Que je fais attention à quelque chose d’important pour qu’une allégorie ait une longueur en bouche importante : la sévérité. La sévérité comme on a pu parler de « style sévère » pour la statuaire antique. Je me préoccupe d’équilibre, j’essaie de marier virilité et délicatesse (je ne dis pas que j’y arrive, j’essaie), tout en faisant attention à ne pas virer austère à la manière d’un David ou d’un Gerhard Richter (Le Richter figuratif… quoi que, sa peinture abstraite aussi est austère) ni pâtissier confiseur (ça, j’en ai déjà parlé. Qui plus est – et c’est un comble – cela pourrait m’être dans certaines conditions facilement pardonné, le kitsch californien est passé par là).
Tu vois, tu l’as ta réponse : je crois que je me dois à un autre combat que celui de ma seule pomme. Je veux participer, du mieux que je peux, à la résistance d’un monde invisible, du monde invisible, en peignant. Et c’est ce qui me distrait. J’aimerais me consacrer à une peinture intime et douce, exclusive, j’en rêve souvent, c’est un projet. Seulement je n’y arrive pas.
J-YJ : Je crois également au monde invisible et ne me souviens pas avoir fait l’apologie du cynisme, fût-il noble. J’avais précisément entrepris, en creusant la veine de l’Idiotie, de partir à la recherche des formes de l’ésotérisme moderne puis contemporain, et sûrement pas de la bouffonnerie ricanante ni du grand Barnum des humours.
J’aime te lire dans ta brillante et convaincante défense et illustration de l’Allégorie. C’est la manière dont on se sent menacé dans son art, et le degré de cet inconfort, qui crée ce spectre d’intensités où Harald Szeemann voulait voir les seules véritables manifestations de l’art. Ce que nous faisons ne doit pas nous être une armure. Ce qui m’étonne, en revanche, c’est ton évocation du Grand Siècle. Si je crois en quelque chose, c’est bien en la République. Toi également ; tu m’en as fait l’aveu. Aussi m’attendais-je davantage de ta part à une évocation des vertus de l’Allégorie à l’ère républicaine. Le bonnet phrygien et le sein nu de Marianne plutôt que dame Justice inspirée de l’Iconologie de Cesare Ripa.
Cette question m’intéresse particulièrement, non pas pour des raisons idéologiques, mais parce que je vois les oeuvres comme des prismes qui nous transmettent une lumière dont nous ne sommes pas toujours à même de reconnaître l’âge ou l’origine, le pedigree en somme. Je voulais donc savoir d’où brillait, d’où provenait exactement cette clarté de l’Allégorie dans tes toiles. De la même manière, j’avais envie que tu nous fasses remonter le cours de la rivière qui emporte Ophélie dans ton oeuvre. Le pedigree également de cette belle morte fleurie au clair de lune.
MM : Le monde invisible, tu en as révélé un tout entier dans Artistes sans oeuvres – I would prefer not to. Je sais que tu n’es pas un cynique ou un nihiliste (nous sommes tous un peu cyniques et nihilistes, sans nous résumer à cela), je sais aussi que l’Idiotie que tu défends a à voir avec l’idiosyncrasie et un jeu de cache-cache. Je suis désolé, je me laisse emporter par une véhémence un peu paranoïde dans l’absolu parce que je vois bien les contradictions, les biscorneries et toutes les lacunes de mes explications… Je ne suis pas un peintre à système, capable de parler de sa peinture sans bavures, parfaitement. Or je vois bien qu’on pourrait le croire, que je donne le change… et je culpabilise à la fois de ne pas être ce peintre extra, extralucide, extracohérent, et de passer pour lui, simplement parce que je parle trop ou que j’ai mon idée sur tout. Je ne suis pas non plus un artiste muré ou instinctif, qui peindrait ses toiles presque « de l’extérieur » et servirait compulsivement en réponse à toute question la petite mythologie du surgissement obscur que l’on entend si souvent dans la bouche des Monsieur Robots. En échangeant avec toi, je m’interroge sur la nature de mon discours, or ce n’est pas le moment. J’ai l’impression de prêter le flanc tandis que j’aimerais bien, moi, avoir une armure. Disons que tout ce que je te dis de ma peinture, il ne faut pas croire que c’est un filet à mailles fines, en nylon solide, que je jetterais sans ciller avec style… il n’attrape rien. C’est plutôt un drôle de radeau, écheveau de plusieurs bois inégaux plus ou moins bien fagotés… mais je crois que cela flotte (je suis dessus en tout cas), et que cela vogue (par à-coups cependant). Mes semi-pans de raisonnements forment ensemble une sorte de radeau, c’est important à savoir.
Pour ce qui est de l’Allégorie, je veux préciser que certains de mes tableaux n’en sont pas. Ils sont minoritaires alors j’en parle moins. Cette mention pour affirmer, ici, la prééminence du tableau sur ma peinture, sa priorité. Je me soucie de produire une proposition esthétique globale, qui passe très vite au second plan si le tableau que je suis en train de peindre me mène ailleurs. Ce qu’on appelle « le style » est une transpiration. Quoi qu’il arrive, on transpire toujours la même sueur. Je ne vois pas l’intérêt de préméditer, de cantonner à l’avance « son style ». Certains fantasment qu’on leur attribue le monopole des ronds verts, d’autres celui des croisillons, comme dans les années soixante dix… C’était déjà lamentable à l’époque alors aujourd’hui, ce serait tout bonnement grotesque ! Le style, je n’y pense pas. Cette sudation naturelle du style que j’évoque envahissant tout, je me laisse la bride sur le cou quand il s’agit de tenter une voltige ou de couper par la forêt avec un tableau. Tout ceci pour relativiser encore l’idée d’une cohérence, qu’elle soit formelle ou, donc, stylistique, parfaitement réfléchie de mon travail. Quitte à me tirer une balle dans le pied en public.
À propos du Grand siècle, j’ai mentionné cette époque parce qu’elle a été une sorte d’âge d’or de l’esprit mythologique et de la peinture d’Église, donc de l’allégorie. Je t’avouerais que j’ai personnellement plutôt une immense admiration pour le XVIIIe siècle, esthétiquement parlant. Politiquement, je suis un vilain républicain, tendance Troisième République, laïcité sans concessions et hussards noirs. Néanmoins la France n’est pas née en 1789 et je le sais, je le sens. D’ailleurs, les rois ont fait la France eux aussi, sa grandeur, son Histoire, son Génie (je vais me faire des amis là). Alors, question peinture, je crois bien être très transversal.
Cependant, si je creuse davantage, j’aurais tendance à trouver les allégories du XIXe assez nazes. C’est le XIXe qui a enterré l’allégorie. Il en a fait une sorte de tract politique lourdingue, univoque, ou bien des panneaux à décorer les palais du Second Empire. Il a à la fois « sécularisé » et « castré » l’allégorie.
La Liberté guidant le peuple, c’est encore parler de Liberté, cependant c’est un peu l’assigner aussi. Alors cela nous plaît cette assignation, ce réalisme. Sur le moment c’était très fort cette irruption de l’allégorie dans l’actualité, dans une Histoire « moderne », et la figure de la Liberté aux côtés de Gavroche sur les barricades, entrant dans le fleuve héraclitéen des événements, c’était brillant. Seulement au bout de quelques dizaines d’années, cette pratique a vulgarisé le genre. On l’a prostitué à mille causes, il a sombré dans l’idéologie, été rabaissé au rang d’image de propagande… (Ceci dit, en y réfléchissant un peu, l’allégorie était déjà à la botte du pouvoir politique au XVIIe, mais elle ne l’était pas systématiquement, cela changeait tout). Des allégories enfin comme La Nuit de Bouguereau (pourtant une des plus réussies. Je n’ai rien contre Bouguereau, j’adorerais en avoir un chez moi, les très coincés jaseraient), des allégories aussi gnangnan, sont tellement vaines, inoffensives, qu’elles ont achevé de discréditer le principe de l’allégorie en en faisant le ramasse-miettes de la mièvrerie des cocottes qui se bousculaient pour monter en premier les marches de l’Opéra Garnier. Il y a eu de nombreuses allégories formidables au XIXe, seulement ce siècle a trop « exploité » l’allégorie, il en a épuisé la sève.
Plus tard, de grands surréalistes comme Magritte ont tenté de réhabiliter le genre, avec des merveilles comme, par exemple, La condition humaine (et d’autres, assez nombreuses au final). Hélas, alors même qu’on en était revenu à de fortes concentrations de poésie et de métaphysique, il n’y avait plus personne pour le voir, pour regarder ces oeuvres sérieusement, pour prendre en considération la portée de ces toiles, et l’on s’est amusé de ce que l’on a pris pour des jeux de mots ou autres fariboles de rêveurs professionnels. Je me souviens de cette jeune Américaine, il y a quelques années, dans la file du Louvre, derrière moi, qui découvrit la poitrine nue de La Liberté guidant le peuple(on y revient) sur un billet de cent francs qu’elle préparait pour acheter les tickets de toute sa famille et qui s’écria rouge de honte et la main sur la bouche : « Oh God, French people are crazy! Look at this! They put naked women on their money! ». A-t-elle eu l’occasion, une fois dans le musée, de faire le lien avec le tableau original, et plus avant avec toute la symbolique révolutionnaire du sein nourricier ? J’en doute.
Le soir, je lis (entre autres Babar et Oui-Oui) à mes enfants des extraits de mythologie grecque. J’essaie d’être un bon parent. Je leur explique que Dédale était le père d’Icare, et qu’il s’est envolé en sa compagnie et n’a pas péri, lui. Qu’il était le concepteur du labyrinthe duquel ils étaient tous deux prisonniers. Je leur parle de Styx, la nymphe, qui a fini par donner son nom à l’un des fleuves des Enfers, et de la pièce que l’on glissait dans la bouche des morts pour payer leur passage dans l’Au-delà au psychopompe Charon. J’essaie de créer en eux les conditions d’un grand « flipper du sens ». Chaque tableau, chaque livre qu’ils liront plus tard entrera dans cette machine, et elle fera beaucoup plus de bruit et de lumière.
Toutes ces précautions étant prises, je peux te parler sérieusement d’Ophélie. Tu évoquais sans doute dans ta question le tableau intitulé officiellement La Marseillaise et officieusement « Brune Ophélie », qui représente en fait ma fille dans une sorte de sarcophage de pompons dont elle semble un peu s’envoler.
Tout a commencé quand, après avoir détesté cordialement Bonnard pendant des années, je me suis rendu compte que j’avais été un âne, que j’étais passé à côté d’un éléphant sans le voir. Je me suis alors beaucoup nourri chez Bonnard. Avec toutes ces baignoires et ces Marthe couchées dedans, il était évident qu’il pratiquait une revisitation compulsive du thème ophélien (une allégorie du chagrin d’amour, du suicide d’amour, terriblement érotique. Tiens ! Encore une allégorie). J’ai découvert dans une biographie anglaise que Marthe avait été effectivement en permanence « au bord du suicide », atteinte autant d’un asthme persistant que de « désordres nerveux », qu’elle et Pierre avaient passé leur vie entre séjours en sanatorium où il l’accompagnait et maisons de campagne paradisiaques (ils étaient libérés du souci de l’argent par une fortune familiale). Bonnard a ainsi peint beaucoup de ses toiles en les piquant sur les murs des chambres qu’ils occupaient lorsque Marthe était en cure. Il savait parfaitement ce qu’il peignait. Eh bien, mon tableau est un clin d’oeil à Marthe, et à cette longue lignée d’Ophélie, puisqu’il y en a eu des tapées, souvent un peu ridicules, mais romantiques au dernier degré et puissamment hypnotiques (comme celle, célébrissime, de John Everest Millais, un chef-d’oeuvre de cucul la praline qui atteint le sublime véritable). Voilà « le pedigree » de ce tableau…
Je me souviens soudain qu’à l’atelier, tu m’avais demandé pourquoi je peignais si souvent des gens couchés, et je t’avais répondu en évoquant la tradition des gisants. Une réponse satisfaisante, véridique, pourtant un tantinet trop téléphonée, trop évidente. Au moment où je t’écris, il m’apparaît évident que tous ces gisants sont en fait des Ophélie, des figures ophéliennes. C’est assez stupéfiant pour moi. Du militaire noir de L’Empire français, dont on ne sait s’il dort ou s’il est mort flottant dans un dégradé tout à fait aquatique, au Bosquet de Vénus où Marie-Antoinette couchée dans les cactus affecte une grâce post mortem, en passant par Le stade du Vel’d’Hiv’ où tous ces corps entassés semblent s’être accumulés là à la manière de ces brindilles à la surface d’un petit cours d’eau qui sont parfois bloquées dans un recoin de berge et forment ainsi une masse abandonnée par le courant. Je réalise que l’utilisation même de l’eau au cours de la fabrication de mes tableaux, l’action de les noyer sous des jus colorés, peut s’apparenter à un procédé « ophélien »… Je ne pensais pas que c’était aussi important, du moins que cette figure pouvait être aussi opérante… Je réalise que c’était sans doute l’intuition initiale de ta question à propos d’Ophélie, que tu as supposé être évident pour moi ce que je viens seulement de réaliser… ou que tu m’as tendu cette clé. Elle est essentielle… C’est une révélation pour moi.
J-YJ : Oui, si le dormeur du val de L’Empire français n’avait été qu’un gisant, il n’y aurait aucune raison pour que ses pieds s’échappent du cadre. On ne voit pas plus les petons de l’Ophélie de Millais, soit que sa robe les dérobe à notre vue, soit que l’eau nous les cache, mais plus sûrement parce que l’image ne les a pas « cadrés ». J’aimerais que tu parles davantage, si tu y vois quelque intérêt, de ce travail sur les tableaux comme activité hydraulique. Ce que tu dis de « l’action de les noyer sous des jus colorés » me trouble grandement, comme s’il existait véritablement — jusqu’à quel degré ? — le rêve de réaliser une rivière, d’irriguer une image, non pas de mimer, mais de convoquer physiquement son flux, d’invoquer Héraclite par son fleuve même.
MM : J’avais été très impressionné par les « peintures de feu » d’Yves Klein, qui laissaient uniquement les traces des volutes de la flamme d’un chalumeau à la surface des toiles.
Cette idée de faire peindre les éléments, je l’ai reprise à mon compte. J’ai voulu faire peindre l’eau, l’air et la terre. Le feu, j’aimerais aussi mais je n’ai pas trouvé une manière à moi avec le feu. Pour l’air, j’utilise l’aérographe et des bombes toutes faites de peinture qui me permettent d’obtenir certains effets de « dispersion » d’une grande douceur, à mon goût. Pour ce qui est de la terre, je répands à la surface de mes toiles des particules qui s’y incrustent et modifient la répartition des jus, justement, dont je te parlais. Ces jus ont la plupart du temps vocation à « coloriser » mes tableaux, souvent à l’origine en noir et blanc. Les toiles sont à l’horizontale, déjà peintes, et je verse le ou les jus colorés à leur surface.
Ces jus, je les travaille tant qu’ils sont fluides à force de projections ou d’inclinaisons, de perturbations par des éléments solides comme la terre, dont je te parlais, avec aussi des graines : des lentilles, du riz, des haricots, etc. Je peins « avec l’eau » pendant cette phase, en sa compagnie, puis je reprends le jus avec des glacis à l’huile, plus tard. Voilà pourquoi je parlais de « procédé ophélien », même si dans le cas de L’Empire francais, le jus a précédé la peinture du militaire, comme dans La Marseillaise d’ailleurs, où il a précédé la peinture de l’enfant. Le jus, « la rivière », était là avant que le militaire ou ma fille ne plongent dedans en quelque sorte. Toutefois, souvent, la figure est peinte avant le jus, elle est noyée au sens propre du terme à un moment de la fabrication du tableau. Il s’agit ensuite de choisir ce qui réapparaît et ce qui reste dessous (parfois je fais ces choix « pendant ». J’ai mes petits secrets pour le comment de ce qui garde la tête hors de l’eau). Yves Klein a aussi réalisé des « peintures de pluie » en fixant sur le toit de son auto des toiles vierges avant de faire un Paris-Marseille par temps maussade. Je réalise plutôt, de mon côté, des peintures fluviales, des peintures sensibles aux courants. Ces mêmes courants de couleurs, axiaux ou radiaux, que l’on peut observer sur mes toiles, si l’on est curieux, et qui forment les grands plans structurant l’espace autour des figures ou à travers elles.
Cette eau est puissante, elle offre une fondation « réaliste » à mes tableaux. « Réaliste » parce qu’ils deviennent de simples plaques d’enregistrement d’une quantité importante d’accidents hasardeux qui, vus d’une certaine distance, semblent toujours s’organiser selon une logique que l’on serait bien en peine de qualifier sobrement, mais qui, allons-nous dire, est la logique de l’eau, la logique de la réalité dans son mouvement, indépendante de ma volonté. Je ne suis pas l’auteur de cette logique, j’essaie tout juste de la capter, de l’intégrer à mes toiles et d’organiser ensuite autour d’elle les projets que j’avais pour le tableau. Je te confirme donc que lorsque j’emploie l’expression « noyer », c’est au sens littéral. Ce n’est cependant qu’une étape, une technique, importante certes mais ponctuelle, dans la réalisation de mes tableaux. J’ai peut-être tort mais je me méfie de ce qui fascine. L’eau en fait partie. Je ne voudrais pas m’y noyer moi aussi (quelque romantique qu’en fût l’idée).
J-YJ : Existe-t-il dans ton parcours, dans ta carrière encore jeune, le souvenir d’une oeuvre — un tableau, mais ce peut être un livre ou tout autre objet — qui n’aurait rien eu d’anecdotique, qui aurait dû même être importante, capitale, éclairante au vu du reste de l’oeuvre, mais à quoi tu n’aurais pas su ou pu donner forme pour mille raisons possibles ? Que ce soit pour des raisons sentimentales, des problèmes d’inspiration, par peur ou par manque d’expérience, du fait d’impossibilités techniques, idéologiques ou autres.
MM : Ta question me rend triste. Elle me renvoie à toutes mes ambitions faramineuses, à tous les rêves que j’ai faits pour chaque tableau, chaque manuscrit, et qui ne se sont pas réalisés, évidemment. Je ne sais pas pour les autres, en ce qui me concerne, le résidu de toutes mes ambitions est là, public : ce sont mes tableaux. Beaucoup ont été détruits ceci dit. À propos de ceux qui restent, je pourrais te répondre que je n’ai ni su ni pu donner correctement forme à rien de ce que j’ai eu en tête.
Techniquement, je pense que je progresse. Techniquement, je le sens. Je crois que l’on peut progresser en art. Il arrive un moment où l’on franchit un seuil, celui de l’expression, et l’on est identifié. Alors même que nous parlons, je ne suis pas certain d’avoir atteint ce seuil. Avec cet entretien, peut-être avons-nous mis la charrue avant les boeufs. Il faudra, si c’est possible, se reparler dans dix ans.
Tu évoques le manque d’expérience et il joue : un manque d’expérience de soi. Savoir s’arrêter, savoir refuser un effet, croire encore pouvoir ressusciter une toile presque morte, être capable de travailler longtemps ou pas, etc. Peindre te révèle rapidement les grandes lignes de ton caractère. Tu sais vite de quel bois tu te chauffes. Ce que l’on appelle « l’expérience » est bien davantage une métamorphose du caractère qu’une accumulation de connaissances. La peinture te confronte immédiatement à la question du repentir, de l’abandon, de l’espoir, à tes croyances, dans sa pratique même, indépendamment du résultat… alors, le caractère doit s’adapter, feinter ou s’endurcir… s’adapter surtout. Tu vois très vite si tu es un peu lâche ou inspiré, peureux ou fort au vent. En une semaine, tu accumules plus d’« expérience » dans ces domaines pointus, éthiques, qu’en une année de vie classique. Ensuite, tu travailles l’existant, tu veux te perfectionner, ou tu abandonnes tout.
Tu parles aussi de « raisons sentimentales » à un échec créatif et je ne sais pas si tu sais à quel point c’est juste, à quel point elle est importante : « la raison sentimentale ». L’obstacle principal quand on avance en âge, passé vingt-cinq ans, quand on est définitivement un adulte, c’est la sclérose, de nos genoux et de nos sentiments. On se recroqueville sur ses souvenirs d’amours anciennes, qui ne font plus vraiment mal, qui ne cognent plus directement en tout cas, que le temps a ouaté. On se moque du romantisme des jeunes, on en ricane, et l’on envie secrètement cet élan sans plus du tout comprendre à quoi il tient et comment ces idiots font pour être aussi aveugles et naïfs, aussi neufs. Quand tu peins pourtant, il faut mobiliser du risque affectif si tu veux atteindre ton meilleur niveau. Tu peux peindre pépère de beaux tableaux avec du métier, mais pour sortir le meilleur, il faut mettre quelque chose sur la table. Ça c’est une difficulté, bien plus que de maîtriser la confection des liants ou le maniement de brosses en poils de dahu. Je disais hier à un ami, au téléphone, quelque chose auquel je crois foncièrement : le spectacle de l’insincérité se débattant contre elle-même est sans doute plus authentique, plus universel, que celui de la sincérité tranquille qui dit tout sans effort, facilement. Sur une toile, il est possible de voir si le peintre a été sincère et, s’il a été insincère, s’il a « essayé » d’être sincère malgré tout. Se déclenchent alors les mécanismes de l’authentique pathos, qui émeuvent fort. Un tableau peut se réussir sur des intentions paradoxales, sur des intentions seulement en fait.
Idéologiquement (pardon de reprendre ainsi un peu scolairement tes termes à la suite, j’essaie de ne rien oublier), idéologiquement donc, je crois m’être libéré de plusieurs soucis idiots. Celui de produire une peinture « contemporaine ». La contemporanéité est inférieure en tout à l’idiosyncrasie, et c’est une peinture absolument sincère, absolument mienne, singulière (pas au sens d’étrange, au sens de personnelle), mon but à présent. Je me suis libéré aussi du contexte politique français de mépris de la peinture. Je m’en fous maintenant, j’expose à l’étranger dès que j’en ai l’occasion… et puis les choses ont un peu changé depuis cinq ans (pas fondamentalement mais un peu). Il faudrait en revanche que je me libère de l’agitation de ma vie. Tu te demanderas ce que cette remarque vient faire au chapitre idéologie. J’ai le culte des autres, des rencontres, des amis, d’Internet… Il faut que je me débarrasse de toutes ces distractions, de tout le monde. Cela me vole un maximum de temps. Seulement j’ai peur de me retrouver seul. Je connais plusieurs artistes que tout le monde a oubliés parce qu’il ont choisi sans compromis l’atelier. J’ai besoin d’une foule autour de moi, d’une foule intelligente. J’en ai besoin d’ailleurs en dehors même de la peinture, par simple frousse basique d’être seul au monde, comme tout le monde.
Bon, je ne réponds pas vraiment à ta question, j’en ai conscience. Je la relis et je fais le cheval de concours hippique qui s’arrête sans raison devant la dernière montagne de barres multicolores. Pour le moment, ce que j’estime avoir fait de mieux, c’est Malabar, une petite vulve rose, toison châtain clair, un zoom surL’Origine du monde, un cadrage sur une béance, un « trou » plus gynécologique que la raie sombre de Courbet. Disons que c’est un tableau dont je suis certain de l’effet. Toutefois ce n’est rien comparé à plusieurs toiles que j’ai voulu peindre et que j’ai plantées lamentablement…
Maintenant si je fais appel à cette moelle, à ce noyau dont tu parlais au début de notre entretien, voici tout ce que j’ai à raconter : enfant, autour de dix ans, je vivais en Guadeloupe avec mes parents. J’ai plusieurs fois essayé à l’époque de peindre un lambi, une sorte de coquillage antillais magnifique que j’avais découvert sur la reproduction d’un tableau d’Odilon Redon et qu’il y avait là-bas sur tous les marchés. Je n’avais que la gouache de l’école à disposition. Au bout de quelques tentatives, j’y suis arrivé. J’ai réalisé une image qui restituait vraiment ce gros coquillage rose, comme sur la photographie du tableau, dans un style comparable d’ailleurs : aquatique, fondu. Dès le lendemain, j’ai essayé autre chose. Je me suis intéressé au dessin, je veux dire au trait, et il a bien fallu une trentaine d’années pour que je revienne à l’eau, que je reparte du souvenir de cette copie enfantine. Au moment où je t’écris, si une oeuvre clé existe, c’est celle-là. Note bien qu’il s’agit d’un souvenir, sans aucun doute embelli à outrance, et cette gouache devait ressembler aux autres gouaches barbouilles d’enfants. À tous les coups, je dois confondre parfaitement dans ma cervelle, depuis trente ans, la somptueuse « coquille » d’Odilon Redon et mon lambi pourrave d’élève de CM2. Tout se mélange dans mon esprit.
Entretien paru dans Marc Molk : Ekphrasis, aux éditions label hypothèse & D-Fiction (janvier 2012) :