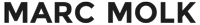Pierre-Yves Quiviger
« La forêt française de Marc Molk », septembre 2008

Je crois que je n’oublierai jamais l’après-midi où Marc Molk m’a montré ce tableau, presque achevé, dans son atelier. J’étais debout, un peu tremblant, la voix cassée, et il me disait « ça s’appelle La libération sexuelle ». Et je voyais bien qu’il y avait une femme jambes écartées, avec l’origine du monde ; je voyais bien sa vulve offerte contrastant avec le haut de son corps inaccessible derrière la couronne d’épines et son visage en larmes.

Mais avant de voir cette femme, j’ai vu son double, derrière, et l’arrière-pays, comme dans le livre d’Yves Bonnefoy, de 1972, l’année de naissance de Marc Molk. J’ai vu la forêt française comme je ne l’avais pas vue depuis Watteau ou Boucher – nuage-vulve, forêt-matrice.

Ordre et désordre du tronc, des branches, des feuilles, tâches pensées, secrets. C’est un tableau si évidemment français, de ce pays de paysans, où la ville n’existe que par rapport à la campagne, où l’urbanité est toujours un peu fausse. La lumière du soleil, le soleil lui-même, n’existe que derrière l’arbre, à droite du tableau. Chaque branche conduit à un autre monde, porte dissimulée. Non, je n’avais pas vu une telle forêt depuis le XVIIIème siècle, une telle ouverture vers la sauvagerie et la sexualité franche au cœur de l’ordre du monde, une telle mélancolie – l’inverse de la forêt vierge : la forêt libertine, philosophique. Entre le visage de la Vénus en fourrure et le tronc de l’arbre, des feuilles d’un vert presque noir vivent leur vie de feuilles, entre un exemple leibnizien – principe des indiscernables : pas deux feuilles identiques, pas deux êtres semblables, pas deux femmes qui se ressemblent, chacune un monde, chaque histoire avec chaque femme, chaque seconde avec chaque femme, un vertige nouveau, un territoire – et des âmes damnées hurlant dans les chaudrons de l’enfer, hésitant entre s’empaler sur les épines ou rejoindre le sol, les racines, et retourner à soi. La femme ressemble aux héroïnes des films de Catherine Breillat, ainsi Caroline Ducey, dans Romance, attachée par François Berléand, et pleurant de bonheur d’avoir enfin connu l’apaisement des liens. Forêt française, mais aussi forêt japonaise, évidemment – la couronne d’épines est moins chrétienne que shibari, comme dans ce beau XVIIIème siècle français si fasciné par le Dit du Genji, dont les scènes ornent tant de meubles d’art. Un jour, Molk peindra Marie-Antoinette, il n’a pas le choix, c’est son sujet, tout le conduit à cela – une Marie-Antoinette bondage, cela va sans dire. Oui, la couronne d’épines est pleine de nœuds, enroulée, et le bleu qui entoure chaque épine est moins le bleu sanglant du ciel de Bataille que celui de la peau laiteuse serrée par la douce corde. Ce sont des épines qui ne font pas saigner mais qui font pleurer de joie, qui frôlent et griffent en surface mais ne font pas couler le sang.

La femme au centre du tableau n’est pas triste, enfin… elle n’est pas plus triste que n’importe quelle princesse, courtisane ou petite paysanne du XVIIIème siècle. Elle est dans la douleur joyeuse de la compréhension des choses. Le monde qui l’entoure ne lui est pas extérieur, elle en est la manifestation la plus vivante, le charmant reflet brûlant. Sur sa droite, on retrouve un sexe, immense et fermé, sans poils, toison vierge, contrastant avec sa motte, en haut de ses cuisses un peu grasses, comme ses mollets et ses chevilles (on ne sort pas, non, pas du tout, du siècle) : sexe nu et épilé de femme debout, aussi grand que la totalité du corps de l’héroïne. Du jaune, du rose, de l’orange, et, enfin, du noir et du vert, comme s’il fallait construire la continuité de la forêt et de la féminité (on songe à Beauvoir, dans les Mémoires d’une jeune fille rangée, à la découverte de la sensualité dans la terre, les arbres, le vent, les champignons et la rosée). A sa gauche, où le marron et le beige du tronc deviennent du rose et les branches noires du bleu Chagall, le trait se disperse et devient mouillé. C’est l’au-delà, qui n’est déjà plus l’arrière-pays. Si on s’occupe des racines, si l’on abandonne la transcendance pour redevenir terrien, paysan, on voit que l’arbre paraît sans racines, justement. Dans cette mousse presque vaporeuse qui fait le lien entre le manteau de fourrure et le tronc de l’arbre, on ne devine rien qui fasse tenir un arbre aussi déraisonnable.

Le manteau de fourrure conduit à l’espace de l’artifice et du jeu. Pas d’animal à poil bleu, pas de cuir rose (il n’y a pas de doublure, le manteau est porté à cru) aussi liquide, plein de vagues, dans la « vraie vie ». Le bassin, la vulve, les cuisses, les mollets, les chevilles, le pied droit sont en-dessous de la couronne d’épines bondage ; alors que le haut du corps est interdit de contact avec l’air par la grâce des nœuds et des épines, les jambes écartées reposent sur le manteau d’un ours imaginaire.

Le corps lié conduit à la jouissance, à la métaphysique (c’est la même chose), à une réinvention du corps – recréation artificielle de la naturalité, de la violence, de la soumission, de la domination, corps déconstruit ; le corps libéré a besoin, lui, de travailler la naturalité de l’artifice pour jouir, par l’imagination, d’une autre métaphysique, plus cérébrale, moins sensuelle, corps double. Le manteau n’existe que « dans la tête », c’est un manteau de volcan (intérieur) et de tornade (extérieur) – le peintre manifeste ce qui surgit du corps libéré, ce qu’invente le corps libéré, son activité. Qu’il soit de fourrure conduit à Sacher-Masoch et à l’idée d’une soumission qui est la plus grande des dominations, selon la formule bien connue, dans la mesure où cette soumission est invention de l’abandon, volonté de la fin de la volonté.

Il y a une forêt qui enferme et une forêt qui libère, une forêt qui m’accueille et une forêt que je fais surgir. Mais ce corps double – ou plutôt triple : le corps réel, le corps symbolique (lié), le corps imaginaire (libéré) – est celui d’une seule femme, jeune et vieille (ses cheveux sont aussi bien bruns que blonds ou blancs), mince (taille presque corsetée, hanches peu pleines) et ronde (cul, cuisses, seins), heureuse et malheureuse.
Le tableau s’appelle La libération sexuelle – on l’aura compris : c’est un pléonasme.

La forêt française de Marc Molk, c’est enfin La troisième République. Je ne sais pas si Molk va finir le tableau ; en réalité, j’espère que non. Il est infiniment japonais et sylvestre en l’état, et il faut que cela reste ainsi. Peut-être quelques traits jaunes sur le bouquet de mimosa, au centre, mais, sinon, il n’y a rien à retoucher ou à ajouter ; ajouter serait ici soustraire de la puissance et de l’évidence. Je vois les choses ainsi : Marc Molk a passé des années à se construire, à se rater, à s’essayer et puis, un jour, comme les vieux, il a compris. Il a compris que les choses étaient finies, achevées, complètes. Cela lui a permis de commencer à comprendre à peu près comment ça marche, une femme, et c’est La libération sexuelle – et c’est facile : ça marche comme un monde, un reflet de la totalité du monde, ça n’est pas un morceau du monde, comme les hommes, c’est un monde, une lecture du monde, d’où une plus haute liberté, une plus grande instabilité, une plus grande capacité à l’acceptation. Ensuite, il a pu devenir vieux et sage et serein (enfin presque) : et il commence ainsi à accepter ce qui le terrifiait avant, la mort, la corruption des choses, l’irréversible. La troisième République est le tableau d’un mort comme La libération sexuelle est le tableau d’une femme, génitif objectif et subjectif dans les deux cas : Molk s’est fait femme pour peindre La libération sexuelle, il s’est fait mort pour peindre La troisième République.

Etre mort, c’est ne plus avoir besoin de la couleur. C’est : quelques traits, de plus en plus fins, la toile dans sa blanche tendresse épurée. Le tronc n’est pas mort, mais les feuilles sont tombées, les choses continuent après, ce n’est pas grave, c’est même plutôt rigolo. Marc Molk prend un pinceau, il suit l’ordre du monde, il s’incline, il est résigné. Il ne fait rien, il obéit. Il est calme, enfin. Il ne pense à rien. Peut-être qu’il pleure quand il arrive à peindre le moment où la brindille morte se détache de la branche et tombe sur le sol mais reste quelques secondes en suspens. Il est alors comme le poète du Fusil de chasse d’Inoué qui aperçoit le « lit de torrent blême » dans la promenade du chasseur, au loin, ou comme Barthes, dans L’empire des signes, qui comprend enfin le pouvoir du silence et de la sobriété, lui qui a tant écrit et parfois si complaisamment. Mon dieu, comme ce tableau est diaboliquement japonais, comme on sent dans chaque geste du peintre la sérénité des gestes anciens, lentement construits.

Si on n’a pas vu grand-chose d’intéressant en France après le XVIIIème siècle, sinon deux ou trois singularités par-ci par-là (Gauguin, Proust, etc.), c’est peut-être par oubli du Japon, par crainte plus générale de l’asianisme et obsession de l’atticisme. Il y a un art admirable du trait dans ce tableau : on suit chacun comme une route conduisant non pas à un monde, cette fois, mais à une fin. Il y a mille petites morts dans ce tableau qui semble dire à la couleur (sauf, peut-être, le mimosa, on verra bien, c’est lui qui peint, moi je ne fais que rêver autour) « ne me touche pas, je suis plus beau de n’être pas touché par la couleur, je suis comme une fleur de cerisier japonais portée par le vent ou comme la rose de Malherbe consolant Du Perrier, qui était là avant ta naissance et qui sera là même après la mort de tes enfants et qui, pourtant, n’existe que le temps d’être saisie par ton pinceau ».
Je vois cela ainsi (donc) : Marc Molk peint chaque trait, puis il s’assoit sur le sol de son atelier, le cul à même le sol (comme moi, écrivant ce texte, en ce 18 septembre 2008), il boit un peu de thé, il est content, il a fait un long chemin, il a parcouru tout entier le long chemin de la vie, maintenant il est mort (façon satori) – autrement dit : il va très bien et il vous embrasse et il pense à vous.